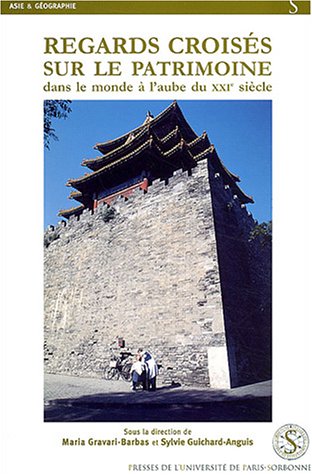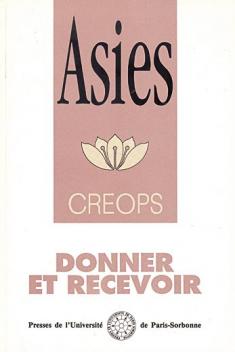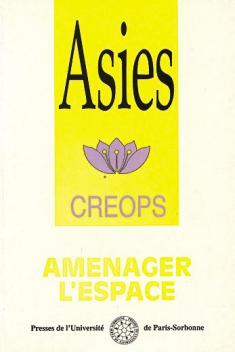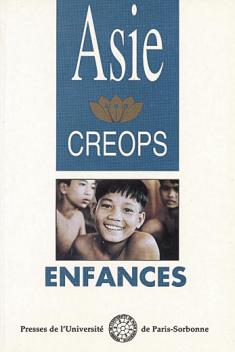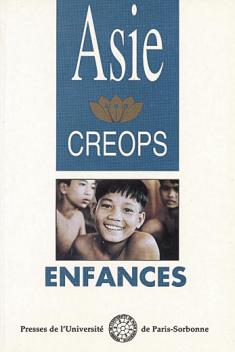
Enfances
Date de publication : 01/01/1997
Format : 16 x 24
Informations : ill. n & bl. coul.
Lire la préface//Commander ce livre//Retour Publications//
Ce quatrième volume de la collection Asie doit permettre au lecteur de comprendre la façon dont les adultes de l’Asie orientale voient leurs enfants et se comportent avec eux.
Le parcours est divisé en trois étapes. Nous avons choisi comme point de départ l’enfant-dieu dans le monde indien (Rama, Krsna ou Bouddha) en ce qu’il dévoile l’enfant idéalisé, tel qu’il devrait être. Les normes culturelles dominantes, par exemple celle de Confucius ou bien la sagesse des anciens Mongols, aussi bien que les projets politiques, de Mao aux Khmers rouges, façonnent une certaine image de la place et du rôle de l’enfant dans la société idéale.
Ensuite, les historiens et les anthropologues ont rapporté de leur campagne d’archives et de terrain, des témoignages sur les rites de naissance, d’initiation ou de passage à la vie adulte des communautés néwar, cinghalaise, indonésienne, malaise, chinoise, japonaise.
Enfin, la dernière partie, pays par pays, nous conduit des traditions culturelles aux situations contemporaines pour mieux appréhender l’enfance dans l’Asie orientale moderne. La perception de l’enfant d’aujourd’hui est ainsi enrichie par le regard de chercheurs qui connaissent bien la réalité d’hier, et parfois mieux que les intéressés.
Comme dans les autres volumes de la collection, nous n’avons cherché ni l’exhaustivité ni le sensationnel, mais nous avons privilégié la rigueur de l’information.
Cependant avec Enfances nous avons conscience d’avoir abordé un domaine plus sensible, plus affectif et donc sujet de passion.
Table des matières :
Flora Blanchon, Introduction
Edith Parlier-Renault, L’Image de l’enfant dans l’art bouddhique de l’Inde.
The Image of the Child in Indian Buddhist Art.
Françoise L’Hernault, La Naissance et l’enfance de Rama et de ses frères. Une peinture du XVIIIe siècle dans le Sud de l’Inde.
Birth and Childhood of Rama and his Brothers. Eighteenth Century’s Painting in South India
Charlotte Schmid, Krisna. L’enfant de Mathura.
Krisna. A Mathura’s Child
Dominique Le Bas, L’Enfance du futur Bouddha sur les armoires laquées et dorées de Thaïlande.
The Chidhood of the Buddha as depicted on Lacquered and Gilt Bookcases of Thailand
Françoise Aubin, Sagesse des anciens, sagesse des enfants, dans les steppes mongoles.
Wisedom of the Elders and Wisedom of the Children in Mongolian Steppes
Ivan P. Kamenarovic, Piété filiale et transgression de l’autorité paternelle dans la Chine ancienne.
Filial Respect and Transgression of Father’s Authority in Ancient China
Jean-Pierre Diény, La Littérature enfantine en Chine au temps de Mao.
Children’s Books during the Period of Mao
André Lévy, Souvenirs d’enfance ? À propos de quelques récits du Liaozhai zhiyi.
Childhood Memories ? About some Liaozhai zhiyi’s short stories
François Martin, « Mes filles chéries », un vieux poème chinois sur les enfants.
My Darling Daughters, and old Chinese Poem about Children
Florence Hu-Sterk, L’Enfant-poète dans la Chine des Tang.
A Young Poet in Tang China
Elizabeth Bopearachchi, Berceuse pour une enfance heureuse. Une étude des berceuses de la communauté cinghalaise.
A Nursery Song for a Happy Childhood. A Study of Nursery Songs in the Sinhalese Community
Jeannine Koubi, Les Deux orphelines. Histoire recueillie chez les Toradja de Sulawesi.
Two Motherless Girls. A Story from Sulawesian Toradja
Josiane Massard-Vincent, Le Début de la vie en Malaisie péninsulaire.
The Beginning of Life in Peninsular Malaysia
Annick Lévy-Ward, « Trois jours, l’enfant des esprits, quatre jours, un être humain ». Les rituels de naissance et d’enfance en Thaïlande.
Three Days, Child of the Spirit, Four Days, the Human Being. The Rituals concerning Birth and Childhood
Anne Vergati, Les Rites d’initiation des jeunes filles néwar (Népal).
The Ritual Marriages of Young Newar Girls ( Nepal).
Fiorella Allio, À Dos de scolopendre, promenade rituelle des enfants dans le sud de Taïwan.
The Ritual Children’s Procession on the Scolopendra’s or Milped’s back in South Taiwan
Guy Mazars, Les Maladies infantiles dans l’Inde ancienne.
Childhood Ilnesses in Ancient India
Anne Behnke Kinney, Privileged and Imperilled : Children of the Han Court.
Privilèges et dangers : les enfants à la cour des Han
Che-Bing Chiu, Un Enfant à la cour des Qing.
A Child at the Qing Dynasty’s Court.
Joy Hendry, Bags, Objects and Education in Japan.
Objets et education au Japon
Marie-Alexandrine Martin, Les Enfants du Cambodge : de la tradition à la modernité
Cambodian Children : from Tradition to Modernity.
Solange Thierry, Enfances khmères d’hier et d’aujourd’hui.
Childhood in Yesterday and Today Cambodia
Gilles Baud Berthier, Aperçu de la jeunesse en Chine depuis les années 1980.
Chinese Youth since 1980s
Muriel Jolivet, Le Coût d’un enfant au Japon.
The Cost of a Child in Japan
Sylvie Guichard-Anguis, Enfance et villes japonaises.
Childhood in Japanese Cities